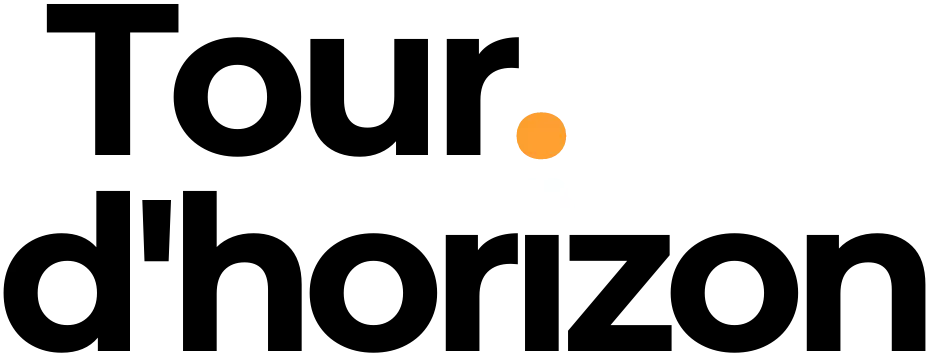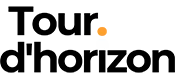Certaines personnes paient littéralement pour sauter d’un avion en parachute. D’autres paient des sommes folles pour être le premier à tester une nouvelle attraction, avant son ouverture au grand public. D’autres encore ne jurent que par les tables de poker “high roller”. Des comportements à la limite du rationnel parfois, mais qui font écho à un besoin biologique profond : le frisson. Pour une partie de la population, ces moments d’incertitude déclenchent une décharge chimique intense que la vie quotidienne ne procure jamais. Comprendre pourquoi certains recherchent ces sensations permet de mieux saisir un trait de personnalité fondamental.
Le frisson est une réaction chimique qui dure moins d’une minute
Le frisson, c’est ce qui se passe dans votre corps quand il détecte un danger potentiel… mais sait en même temps qu’il est en sécurité. Cette contradiction bizarre déclenche en réalité une cascade de réactions chimiques dans le cerveau. En clair, votre corps s’affole un peu, puis se calme, et cette montagne russe interne procure une forme de sensation intensément inattendue.
Et c’est là que le corps libère deux substances chimiques principales. D’abord la dopamine, qui crée une sensation de plaisir et d’anticipation. Ensuite l’adrénaline, qui donne un coup de fouet énergétique. Le cœur bat plus vite. L’attention devient maximale et l’essentiel des évènements périphériques disparaît, créant une sorte de bref effet tunnel pour le sujet.
Imaginons un joueur qui entre dans un casino de Deauville, échange de l’argent contre jetons au guichet, puis s’installe à une table de roulette. La roulette, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c’est ce grand plateau tournant avec des cases numérotées rouges et noires. Le croupier lance la bille, celle-ci tourne pendant environ 10 secondes avant de s’arrêter sur une case.
Ces 10 secondes sont le laps de temps durant lequel le cerveau du joueur ne sait pas ce qui va se passer. Va-t-il perdre ses 100 euros ou les doubler pour repartir avec 200 euros ? Cette incertitude crée un mini-danger dans l’esprit. Ce n’est pas un vrai danger comme se retrouver face à un lion, mais le cerveau réagit tout de même. Gagner procure évidemment un plaisir supplémentaire, mais la décharge chimique principale est déjà passée.
Aujourd’hui, bon nombre de joueurs ne se déplacent plus à Deauville, Biarritz ou Enghien-les-Bains pour les jeux de tables et la roulette. Tout peut se faire sur le web ou sur son smartphone, à travers les casinos en ligne.
Ces opérateurs régulés proposent aux joueurs français (et européens) les mêmes jeux que leurs équivalents physiques, mais avec des mises largement plus accessibles (dès 10 centimes le tour à la roulette ou la blinde au poker). On dépose des euros ou, plus souvent, des Bitcoins et autres cryptomonnaies (source : https://99bitcoins.com/fr/bitcoin-casino/). D’où leur nom de “Bitcoin casinos”.
Un frisson “universel”, mais ressenti à des degrés différents
Toujours est-il que cette réaction est universelle. Tout le monde la ressent à des degrés divers. Mais certaines personnes en ont davantage besoin que d’autres. La raison est biologique. Environ une personne sur trente possède un récepteur à dopamine légèrement différent, moins efficace pour capter cette substance.
En clair, cela signifie que leur cerveau doit produire plus de dopamine pour ressentir la même chose qu’une autre personne avec un simple café ou une bonne nouvelle. Quand on vous qualifie de “téméraire” ou de “tête brûlée”, cela a donc tout simplement une explication parfaitement étayée par votre anatomie !
Ces personnes ne recherchent pas le danger pour le danger. Elles recherchent cette décharge chimique que leur corps produit moins facilement. Leur seuil est plus élevé. Là où certains trouvent leur dose de frisson en regardant un film d’horreur, d’autres ont besoin de sauter d’un avion ou de prendre des risques importants sur une entreprise.
Ce n’est ni un choix ultra-conscient ni un défaut de caractère. C’est simplement leur façon de fonctionner.
Ce besoin vient de notre passé de chasseurs
Plusieurs études attribuent cette recherche de frisson à la génétique même, elle remonterait à très loin dans notre histoire. Il y a 15 000 ans, nos ancêtres vivaient pour une large part de la chasse et de la cueillette. Pour manger, ils devaient donc soit affronter, soit éviter des animaux dangereux. Un sanglier menaçant, tenu en respect ou chassé avec une simple lance en bois, vous exposait à un risque réel de mort.
Chaque fois qu’ils surmontaient un danger et revenaient vivants avec de la nourriture, leur corps libérait une grosse dose de dopamine. Cette sensation de plaisir intense après avoir survécu n’était pas un hasard. C’était un système à la fois de récompense et de soulagement. Les humains qui ressentaient cette récompense plus fortement étaient plus audacieux, chassaient mieux, se nourrissaient mieux, et survivaient plus longtemps. Ils transmettaient ensuite ce trait à leurs enfants.
Pendant des dizaines de milliers d’années, ce mécanisme a assuré notre survie. Mais aujourd’hui, tout a changé. Nous vivons dans un monde extraordinairement sécurisé, policé comparé au passé. La nourriture s’achète au supermarché. Aucun prédateur ne nous menace, ou presque. Les risques mortels au quotidien ont quasiment disparu.
Le problème, c’est que notre cerveau n’a pas évolué aussi vite que notre mode de vie. Il cherche toujours ces moments d’intensité qui n’arrivent plus naturellement. Résultat : certaines personnes créent artificiellement ces situations pour retrouver cette sensation ancestrale.
Les façons de le faire sont diverses. Les sports extrêmes en sont l’exemple le plus évident. Un saut en parachute d’un hélicoptère sur un versant du Mont Blanc, l’escalade en haute montagne, le ski hors-piste, le surf sur de grosses vagues : toutes ces activités créent l’illusion du danger… mais avec un danger réel largement amoindri par les équipements de protection.